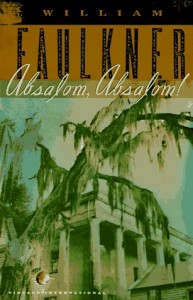 Faulkner, vainqueur par forfait… Je jette l’éponge. Ca n’arrive pas souvent, je crois que c’est la première fois, adulte, que j’abandonne vraiment une lecture. Peut-être que je m’y remettrais un jour mais je ne vois pas ce qui pourrait me motiver.
Faulkner, vainqueur par forfait… Je jette l’éponge. Ca n’arrive pas souvent, je crois que c’est la première fois, adulte, que j’abandonne vraiment une lecture. Peut-être que je m’y remettrais un jour mais je ne vois pas ce qui pourrait me motiver.
Absalon, absalon a été écrit en 1936 par l’américain William Faulkner qui a été nobélisé en 1949 pour son oeuvre. Ce roman relate la création et l’histoire d’une famille du Mississippi à la fin du XIXème siècle à l’époque de la guerre de Sécession : Thomas Sutpen, inconnu dans le village, se pointe avec esclaves et architecte pour y construire une immense plantation. Quelques années plus tard, il épouse Ellen Coldfield la fille du « Oleson du coin » qui lui donnera deux enfants, une fille Judith et un garçon Henry. La guerre de sécession pointe le bout de son nez, ravage la région et ses habitants. Les hommes de la maison survivent mais une fois la guerre finie, Henry tue le fiancé de Judith, le reste meurt dans des circonstances qui ne sont révélées que dans la partie du bouquin que je n’ai pas lue (ce que je viens de raconter est révélé dans l’introduction du livre).
Sur le papier, tout semble véritablement intéressant : une tragédie orchestrée sur un fond d’Amérique sudiste dévastée et traumatisée. D’autant moins que ce roman a été écrit par un sudiste lui-même à une époque où le racisme était encore viscéralement ancré dans les mœurs. C’est pas vraiment la petite maison dans la prairie.
Le problème c’est le style : lourdingue à mort. Les phrases ponctuées de point-virgules font en moyenne une demie-page, hachées et alambiquées au point qu’arrivé à la fin, on a oublié le début. C’est pire que du Proust : non seulement on se perd dans le récit à force de digressions mais en plus on se perd à même les phrases. Le récit de la page précédente tient du souvenir de la petite enfance ; quand on lit ce bouquin, on a l’impression d’avoir une mémoire de poisson rouge et on progresse dans le récit avec des souvenirs parcellaires de ce qu’on vient de s’enquiller et avec la désagréable impression que Faulkner radote. Arrivé à la moitié du bouquin, je suis arrivé tant bien que mal à comprendre ce qu’il a voulu dire dès le premier chapitre (le pitch plus haut).
Faut pas déconner, j’ai autre chose à faire.
Je clos le bouquin et je sors World War Z que je dois finir et reviewer avant le 20 juillet (lecture commune sur Livraddict).
Pas un avis sur ce bouquin-ci précisément mais sur un autre du même auteur : Marianne Desroziers qui donne un avis différent du style de Faulkner (et pointe du doigt un autre écrivain sudiste, Carson Mac Cullers).
httpv://www.youtube.com/watch?v=ofrSio_jZO0
10 comments for “Critique de "Absalon, absalon" de William Faulkner”